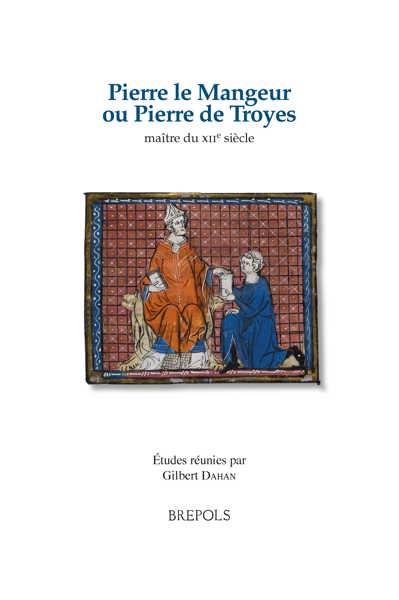Des roues pour penser
La "Vision du char" d'Ézéchiel, modèle visuel de l'intelligence au Moyen Âge
Véronique Rouchon Mouilleron
- Pages: 516 p.
- Size:156 x 234 mm
- Illustrations:24 b/w, 113 col.
- Language(s):French
- Publication Year:2026
- € 120,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-61153-2
- Paperback
- Forthcoming (Mar/26)
- € 120,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-61154-9
- E-book
- Forthcoming
*How to pre-order?
Support circulaire de tout véhicule en mouvement, la roue est aussi pour les savants du Moyen Âge une modélisation des opérations de la pensée, une représentation de l'intelligence en acte.
Maître de conférences HDR en histoire du Moyen Âge à l'université Lyon2, VRM est ancienne élève de l'École normale supérieure (Paris) et agrégée de lettres classiques. Elle a été formée en histoire de l'art à la Scuola Normale Superiore de Pise, puis à l'université de la Sorbonne. Ses principaux domaines de spécialité sont l'histoire de la culture visuelle, plus spécialement en Italie et en France entre XIIe et XIVe siècles, l'étude des manuscrits enluminés et l’iconographie historique.
Le Moyen Âge a utilisé des diagrammes de toute forme en tant qu'outils cognitifs. Parmi eux, le graphique circulaire (qualifié de roue, ou "rota", dans son appellation médiévale) vaut, de manière plus englobante, comme une figuration de toute opération mentale. Le succès de ce modèle graphique de la roue dérive du début du livre biblique d'Ézéchiel, connu sous le nom de « Vision du char » de Yahvé, où le prophète voit apparaître un être à quatre têtes (d'homme, d'aigle, de lion et de veau), monté sur une roue, puis deux, puis quatre, qui sont mues en un mouvement perpétuel et centrifuge. L'image, qui a beaucoup intrigué les pères de l’Église, a servi à illustrer la concordance entre l'ancien et le nouveau Testament, et aussi la relation entre l'Écriture et son lecteur. Cette idée, reprise et développée par les savants médiévaux est comprise, au-delà de sa visée exégétique, comme un modèle de tout processus interprétatif. L’enquête sur ces "rotae" s'est efforcée de suivre la réception de cette première Vision d’Ezéchiel à travers une série de commentaires chrétiens jusqu’au XIVe siècle, en cherchant toujours, conjointement, la matérialisation de ces commentaires dans le domaine visuel. Cet ouvrage, en accordant, autant que possible, une part égale aux textes et aux images, veut restituer toute sa densité à une histoire culturelle capable de mettre en contact étroit histoire intellectuelle et histoire visuelle.
Introduction
I - La « vision du char » de Yahvé
I-1. Chercher le char
I-2. Les "animalia" : Tétramorphe ou Quatre vivants ?
I-3. L’élément discriminant : les roues
II - Des roues pour l’exégèse jusqu’au XIe siècle
II-1. La roue des premiers Pères
II-2. Les Homélies de Grégoire sur Ezéchiel
II-3. Roues grégoriennes du haut Moyen Âge
III - La roue au XIIe siècle : entrée en scène
III-1. Expériences visionnaires entre Meuse et Rhin
III-2. Pratiques scolaires dans la France du Nord
III-3. À l’école d’Étienne Langton
IV - Récapitulatifs visuels : trois déclinaisons entre 1170 et 1230
IV-1. L’exégèse grégorienne dans la Bible de Floreffe
IV-2. Un évangéliaire germanique et les enveloppements de l’Écriture
IV-3. Histoire et allégorie : Ez 1 dans la Bible Moralisée
V - Figures du calabrais Joachim de Flore
V-1. « Ezechielis rotis diligenter inspectis »
V-2. Une autre leçon : les Praemissiones
VI - Roues scolastiques et frères mendiants
VI-1. Lectures d'Ez 1 chez Hugues de Saint-Cher
VI-2. « S’avancer au milieu des roues », un modèle pour les études
VII - une version monumentale au baptistère de Parme
VII-1. Architecture et dispositifs visuels
VII-2. La médiation franciscaine
VIII- Ezechiel à Avignon
VIII-1. Une nouvelle exégèse des roues : le traité d’Enrico del Carretto
VIII-2. Opicino de Canistris ou la roue au risque de l’obsession
Conclusion
Annexes
Bibliographie