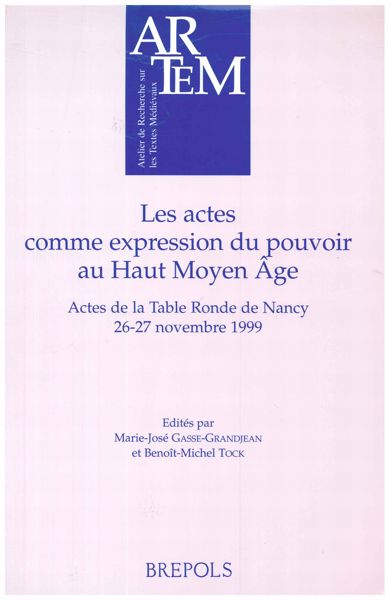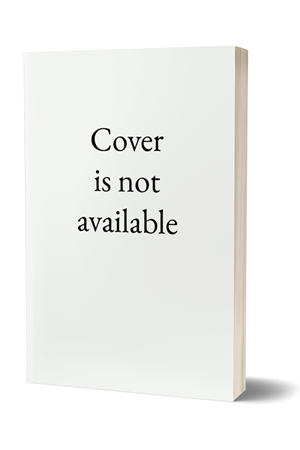Des moines et des actes
Les pratiques de l'écrit diplomatique chez les cisterciens au xiie siècle (La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimond)
Marlène Helias-Baron
- Pages: 360 p.
- Size:156 x 234 mm
- Illustrations:40 b/w, 4 col.
- Language(s):French, Latin
- Publication Year:2026
- € 110,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-61813-5
- Hardback
- Forthcoming (Apr/26)
- € 110,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-61814-2
- E-book
- Forthcoming
*How to pre-order?
Des moines et des actes : les pratiques de l'écrit chez les cisterciens au XIIe siècle
Marlène Helias-Baron est ingénieure de recherche en analyse de sources à l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT-UPR 841). Elle a soutenu en 2005, sous la direction de Michel Parisse, une thèse consacrée à la diplomatique cistercienne au XIIe siècle et plus particulièrement aux pratiques de l’écrit de La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimond. Elle travaille sur les manuscrits médiévaux, les livres d’archives, les écritures anciennes et leur exploitation par des outils numériques.
Au cours du XIIe siècle, les quatre premières filles de Cîteaux (traditionnellement reconnues, en tenant compte des travaux récents sur Preuilly peut-être fondée en 1116), fondées entre 1113 et 1117, ont eu des pratiques communes, à savoir un réel empressement à obtenir des écrits pour préserver la mémoire de leurs acquisitions accompagné d’un souci constant de conservation de leurs originaux, la rédaction d’une grande majorité de leurs actes par leurs scriptoria respectifs, une forte tendance à se tourner vers les évêques pour notifier et/ou confirmer leurs documents. Si le recours aux pancartes est une pratique courante, presque une routine, à La Ferté, Clairvaux et Morimond pour toute la période, à Pontigny en revanche un autre choix a été fait en mettant en chantier dès les années 1160 un premier cartulaire. Ces dissemblances sont liées non seulement à la structure différente des acquisitions faites par les monastères entre, d’une part, les trois premiers qui ont vu grossir leurs patrimoines par l’entrée d’une multitude de biens de petite taille et, d’autre part, Pontigny qui a acquis des terres de plus grandes dimensions, mais aussi aux usages des diocèses dans lesquels ils sont implantés. Celui d’Auxerre en effet ne semble pas avoir eu recours aux pancartes alors que la pratique s’est développée dans ceux de Langres, de Toul, de Chalon ou encore de Besançon, notamment pour notifier les biens acquis par les ordres nouveaux, cisterciens comme prémontrés. Dans ces conditions, ces quatre abbayes sont à la fois des réceptrices d’usages extérieurs qu’elles adaptent à leurs besoins et des productrices de solutions innovantes pour traiter la documentation reçue.
Chapitre premier. Les actes dans toute leur diversité
Chapitre deux. Les pancartes : entre actes récapitulatifs et chartes confirmatives
Chapitre trois. Des actions aux actes : le rôle de la société régionale dans la constitution des patrimoines
Chapitre quatre : Auteurs, autorités et validations des actes : les choix stratégiques des cisterciens
Chapitre cinq. Le discours diplomatique comme révélateur du milieu de rédaction
Chapitre six. Jeux d'écriture sur peau de parchemin