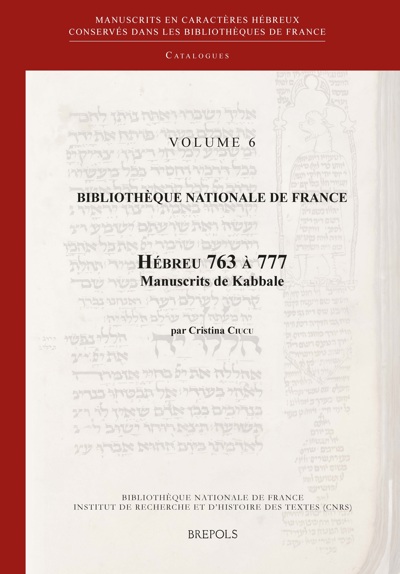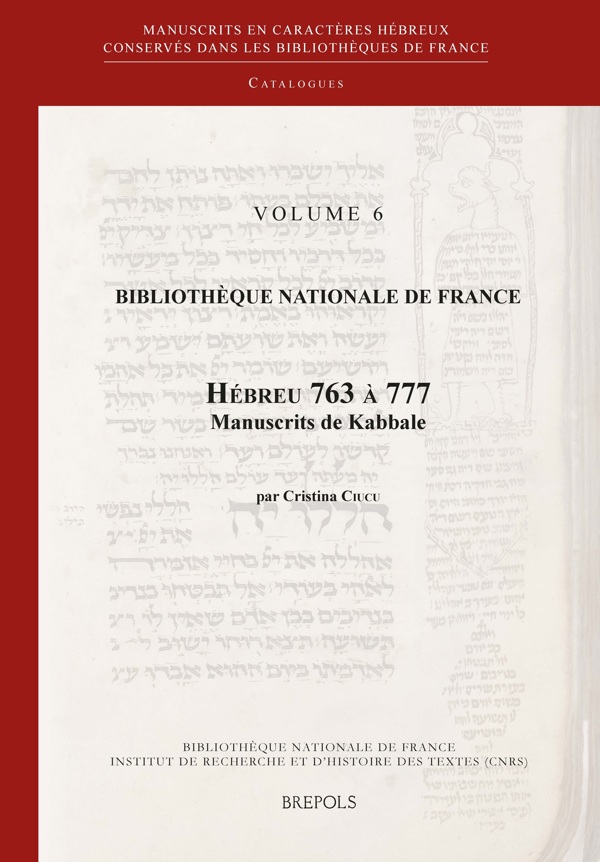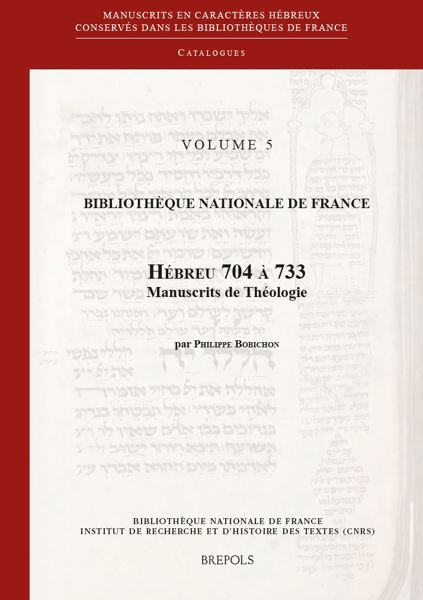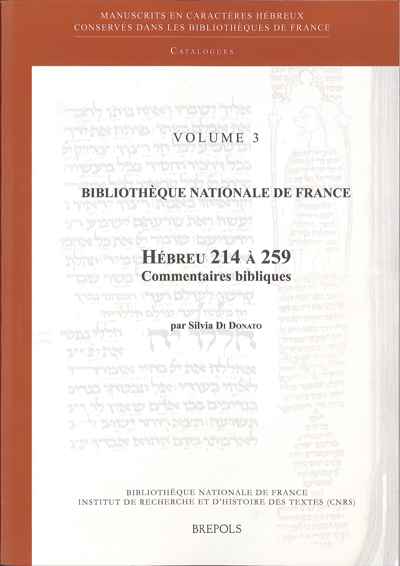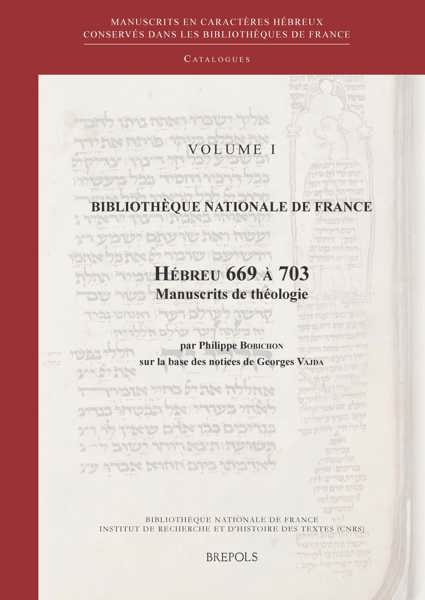
Bibliothèque nationale de France. Hébreu 763 à 777. Manuscrits de Kabbale
C. Ciucu
- Pages: 260 p.
- Size:210 x 297 mm
- Language(s):French, Hebrew
- Publication Year:2014
- € 115,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-54546-2
- Paperback
- Available
Ce volume offre le premier examen systématique de manuscrits de Kabbale selon les principes novateurs qui sous-tendent l’ensemble de la collection. Il met en évidence la richesse de ces manuscrits, leur très grande complexité et l’apport de la méthode adoptée dans cette collection pour l’étude scientifique de la tradition mystique juive.
Les manuscrits décrits dans ce volume furent produits en des lieux très divers (Italie, France, Espagne, Maroc, Tunisie, Jérusalem, Ashkenaz) et sur une période qui s’étend de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe. Dans cet ensemble composite, ceux qui furent copiés en Italie du Nord, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, par des mains séfarades ou italiennes, prédominent. Les textes sont le plus souvent rédigés en hébreu ou en araméen, mais aussi, parfois, en judéo-arabe.
Comme dans la plupart des manuscrits de Kabbale, ces textes sont fort nombreux (167 au total dans les manuscrits ici décrits), souvent fragmentaires ou mal distingués dans la mise en page ; leur teneur est assez variée pour pouvoir être considérée comme représentative de la très grande diversité de la tradition kabbalistique, de ses rapports avec d’autres aspects du savoir (philosophie, exégèse, théologie), et de la place qu’elle occupe dans l’ensemble de la littérature juive médiévale. Parmi ces textes, certains furent largement diffusés, d’autres moins, la copie de la Bibliothèque nationale de France étant parfois l’unique exemplaire conservé ; d’autres enfin — une grande partie de ceux qui sont décrits dans ce volume — sont anonymes ou d’attribution incertaine : pour ces derniers, la description de la copie s’accompagne, dans la mesure du possible, d’un examen critique permettant d’envisager leur identification. Dans certains cas, cette identification est explicitement proposée. Dans tous les cas, l’analyse du contenu textuel est effectuée à la lumière des données conjointement offertes par l’examen codicologique et paléographique, par la comparaison avec d’autres témoins et par la bibliographie existante.
L’examen de ces manuscrits met en évidence certaines modalités pratiques et intellectuelles de l’étude de la Kabbale au Moyen âge et à la Renaissance par les juifs, et parfois même par des chrétiens. Il devrait contribuer au progrès des études relatives à la Kabbale en soulignant la nécessité de toujours prendre en compte la matérialité des manuscrits dans l’examen des textes, des idées, et de leur histoire.