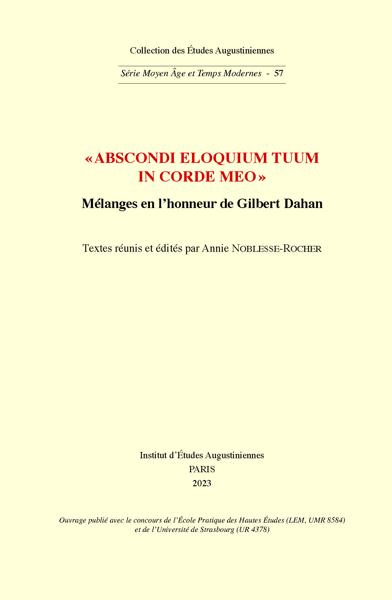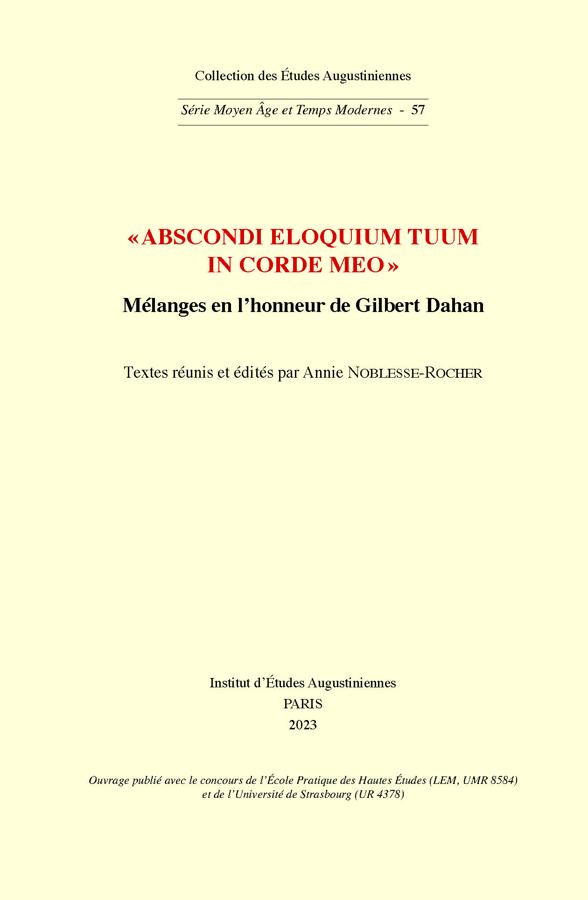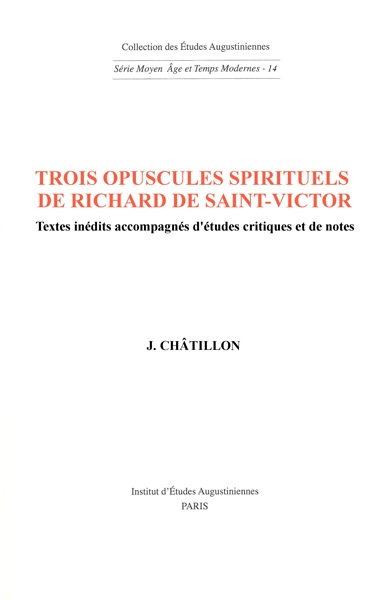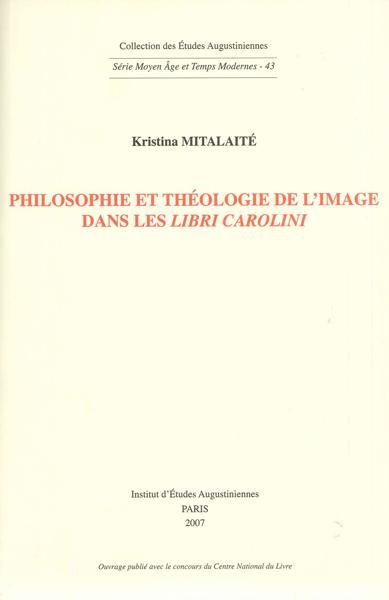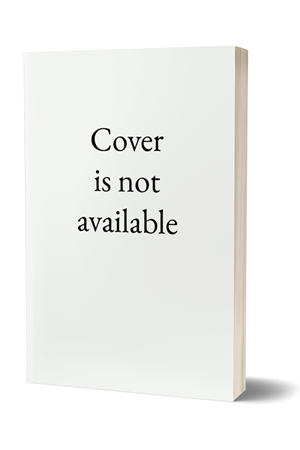
« Abscondi eloquium tuum in corde meo ». Mélanges en l’honneur de Gilbert Dahan
Annie Noblesse-Rocher (ed)
- Pages: 472 p.
- Size:160 x 245 mm
- Illustrations:7 b/w, 5 tables b/w.
- Language(s):French
- Publication Year:2024
- € 60,66 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-85121-330-3
- Hardback
- Available
Abscondi eloquium tuum in corde meo, « Thy word have I hid in mine heart » (Ps 119, 11). Under this title, colleagues, disciples and friends of Gilbert Dahan have decided, on the initiative and under the direction of Annie Noblesse, to address him a collection of Mélanges in homage to his scientific work and the profound renewal he has brought to various fields of research: the phenomenology of medieval liturgical games, relations between Jewish intellectuals and Christians in the Middle Ages, and medieval Christian exegesis. Based on his interest in medieval exegesis, its history and reception, they offer twenty-one contributions, classified under five headings: elucidating, glossing and commenting, interpreting, conferring and preaching. A study of the musical setting of Ps 101 by Pierre César Abeille (1674-1733), whose works appeared in a manuscript of the Bibliothèque nationale de France, also pays tribute to the musician and music lover to whom this book is dedicated. The volume also includes a list of Gilbert Dahan’s works and publications.
Abscondi eloquium tuum in corde meo, « J’ai ton parler reserré en mon cueur » (Ps 119, 11). Sous ce titre des collègues, des disciples, des amis de Gilbert Dahan ont souhaité, à l’initiative et sous la direction d’Annie Noblesse, lui adresser un recueil de Mélanges en hommage à son œuvre scientifique et au profond renouvellement qu’il a apporté dans divers champs de recherche : la phénoménologie des jeux liturgiques médiévaux, les relations entre les intellectuels juifs et les chrétiens au Moyen Âge ou encore l’exégèse chrétienne médiévale. Autour de son intérêt pour l’exégèse médiévale, son histoire et sa réception, ils lui offrent vingt-et-une contributions, classées en cinq rubriques : élucider, gloser et commenter, interpréter, conférer, prêcher. Une étude de la mise en musique du Ps 101 par Pierre César Abeille (1674-1733), dont les œuvres sont parues dans une édition manuscrite actuellement conservée à la Bibliothèque nationale de France, rend aussi hommage au musicien et au mélomane qu’est le dédicataire de cet ouvrage. Figure également dans ce volume une liste des travaux et des publications de Gilbert Dahan.
Ouverture (Annie Noblesse-Rocher)
Travaux et publications de Gilbert Dahan
Abréviations
Prémière partie. Élucider
1 Rois 13 ou l’histoire d’un prophète qui ment, d’un homme de Dieu qui désobéit et d’une parole divine irrévocable (Alfred Marx)
Réinterprétations chrétiennes de la Pâque juive au miroir du Nouveau Testament (Christian Grappe)
Deuxième partie. Gloser et commenter
Les exploits de Samson au regard des Pères (Jg 14 – 16, 3). Les ruses de la typologie (Martine Dulaey)
Extraits du Contra Fabianum perdu de Fulgence de Ruspe dans le Liber glossarum (VIIe siècle) (Anne Grondeux)
Théologie naturelle et révélation de Dieu. Thomas d’Aquin commentateur de Romains 1, 20 (Olivier Boulnois)
Lectio divina et exégèse. Sur quelques options exégétiques de Benoît XII dans le traité 28 de son commentaire de l’Évangile de Matthieu (Christian Trottmann)
Exégèse littérale, logique analytique et critique textuelle chez R. Moïse Almosnino (Salonique, v. 1515 – Constantinople, v. 1580) (Jean-Pierre Rothschild)
Mathieu Béroalde et Bertin Le Comte, annotateurs des leçons de François Vatable en 1538 sur 2 Samuel 11 et 12 (David et Bethsabée) (Max Engammare)
Entracte musical. Domine exaudi orationem meam. Le Psaume 101 de Pierre-César Abeille. Pénitence et conversion (Grace Milandou)
Troisième partie. Interpréter
Une quadruple théorie de l’exégèse au XIIe siècle (Dominique Poirel)
De l’exégèse à l’herméneutique, et retour. Quelques enseignements de la lecture de Hugues de Saint-Victor par Henri de Lubac et Gilbert Dahan (Antoine Guggenheim)
Exégèse d’Aristote. Les méthodes de quelques interprètes vers 1240-1255 (Olga Weijers)
Un passeur de l’humanisme au XVe siècle. Le chanoine messin Nicole Dex († Mireille Chazan)
Jean Constans, ministre réformé à Montauban, interprète du Livre de Daniel en un temps de guerre, 1567-1586 († Bernard Roussel)
Quatrième partie. Conférer
Hebraica Veritas: Iudaeorum Caritas? Christian Hebraism in the Middle Ages and the Attitude towards Judaism (Ari Geiger)
Peter Comestor, the Christian Josephus (Mark J. Clark – John C. & Gertrude P. Hubbard)
The Protestant Reformer of Strasbourg and the Rabbi of Mediaeval Narbonne. Martin Bucer Reading David Qimḥi on Psalm Two (Gerald Hobbs)
Jean Calvin et les Juifs (Matthieu Arnold)
Cinquième partie. Prêcher
Exégèse et prédication. Lectures plurielles de la sainte Écriture (XIIe-XIIIe siècles) (Nicole Bériou)
L’exégèse dans la prédication de Pierre le Mangeur (Franco Morenzoni)
Prêcher après la Saint-Barthélémy. Les Funérailles de Sodome et de ses filles du pasteur Robert Le Maçon (Annie Noblesse-Rocher)
Indices
Index scripturaire
Index des manuscrits
Index des auteurs anciens
Index des auteurs modernes et contemporains