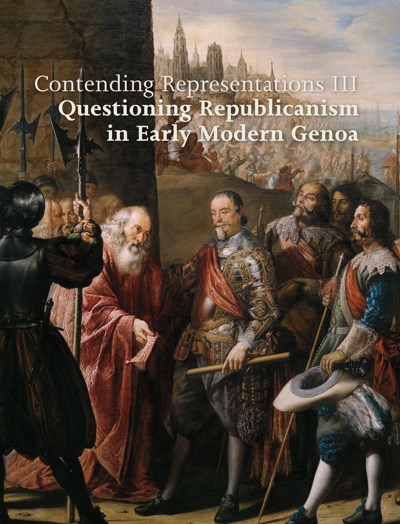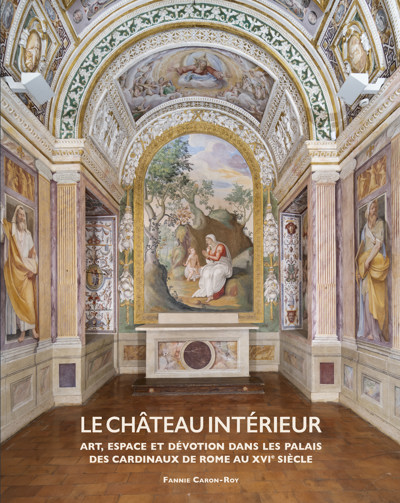Physique de l’Incarnation
Enfanter et prendre corps dans l’art italien de la Renaissance
Philippe Morel (ed)
- Pages: 347 p.
- Size:216 x 280 mm
- Illustrations:2 b/w, 176 col.
- Language(s):French
- Publication Year:2025
- € 125,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-61408-3
- Hardback
- Available
Le point de vue sur l’Incarnation ici développé se joue principalement dans le rapport au corps marial où le Verbe s’est fait chair. On a cherché à montrer comment les artistes de la Renaissance se sont attachés à figurer la nature éminemment physique et l’imaginaire spatial de l’Incarnation, variablement abordée sous l’angle de la conception et de la gestation, de la naissance et de la sortie du jeune corps.
Philippe Morel est professeur émérite d’histoire de l’art de la première modernité à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, membre senior honoraire de l’Institut Universitaire de France et membre de l’Academia Europaea. Spécialiste de l’art italien de la Renaissance, il a publié divers ouvrages principalement consacrés aux décors médicéens du second Cinquecento, aux grotesques, aux grottes artificielles, au rapport entre science, astrologie et magie et, plus récemment, à la culture dionysiaque. Il a également dirigé les actes d’un colloque intitulé “Voir l’au-delà. L’expérience visionnaire et sa représentation dans l’art italien de la Renaissance”.
La question de l’Incarnation est ici abordée selon son acception la plus charnelle, la plus physique voire la plus physiologique, d’abord du point de vue du lieu matriciel que sont la maison, le lit et le ventre de la Vierge, puis en tant que mouvement épiphanique de venue au monde, avant d’en considérer les prolongement et variations au sein d’autres contextes thématiques. Les nombreuses images qui se trouvent convoquées et analysées témoignent de l’intérêt que les artistes, les commanditaires et le public de la Renaissance italienne ont porté pour des considérations très humaines qui reconduisent Marie à son état de simple mère.
L’approche adoptée oscille entre la mise en évidence d’une réalité physique de la gestation et de la parturition, qui répond à la dévotion mariale des couples et des jeunes mères contemporaines en s’attachant à des questions de nature obstétrique, et l’abstraction figurale d’une réalité textile qui interpelle l’imagination et la méditation pour les inviter à contempler l’empreinte ou la marque du divin dans une matière qui se donne comme l’enveloppe et la chair du Verbe incarné. L’idée de sortie ou de surgissement, de seuil ou de passage, est tout aussi prégnante dans son rapport aux drapés organiques de la Vierge dont s’extrait l’Enfant. Ce sont autant de détails qui, dans le sillage d’écrits apocryphes anciens et d’une littérature mystique féminine plus récente, témoignent pour l’essentiel du détournement ou de la mise en évidence par les artistes d’un impensé théologique, celui des conditions précises de la naissance de Jésus.
Introduction
Philippe Morel
« Confirmer l’Incarnation ». Nicée II et les théologiens de l’image
Maxime Deurbergue
Première partie : L’Incarnation en son lieu
« Descendit de cœlis ». Exégèse visuelle et paysage de l’Incarnation dans la peinture siennoise du Quattrocento
Anne-Laure Imbert
L’invention d’une figure matricielle. La Santa Casa et l’iconographie de la Madone de Lorette (XVe-XVIIe siècles)
Ralph Dekoninck
« Creando el Creatore nel tuo talamo mondo ». L’herméneutique du Thalamus Virginis à la Renaissance
Fiammetta Campagnoli
L’Incarnation et l’oreille dans l’art italien de la Renaissance
Marta Battisti
De l’imago clipeata à la mandorle utérine. Ouverture et profondeur du lieu de l’Incarnation au XVe siècle
Clémence Legoux
Deuxième partie : Venir au jour, venir au monde
La qualité émotive du drapé organique. Une image de l’amour maternel, de Gentile da Fabriano à Jacopo Bellini
Marie Piccoli-Wentzo
Enfanter le Sauveur, naître de la Vierge. Michel-Ange et l’impensé de l’Incarnation
Philippe Morel
Culture de l’ornement et physique de l’Incarnation. Les dispositifs textiles de l’image mariale à la Renaissance
Juliette Brack
Encadrer l’Incarnation. Le cadre fictif dans la Vierge à l’Enfant avec deux anges de Filippo Lippi (Galerie des Offices, Florence)
Elizaveta Falkova
Troisième partie : Aux marges de l’Incarnation
Corps régénérés. La chair, la légèreté et la pesanteur des élus et des damnés au jour du Jugement
Angèle Tence
La chair et la voix du spectre. Interprétations picturales de l’ombre de Samuel
Pierre Tchekhoff
Roch, gynécologue-obstétricien céleste au chevet des femmes
Florence Larcher
Fertilité de la nature et fécondité humaine dans la peinture flamande du début du XVIIe siècle. Réflexions autour de la figure de Cérès
Cassandre Herbert