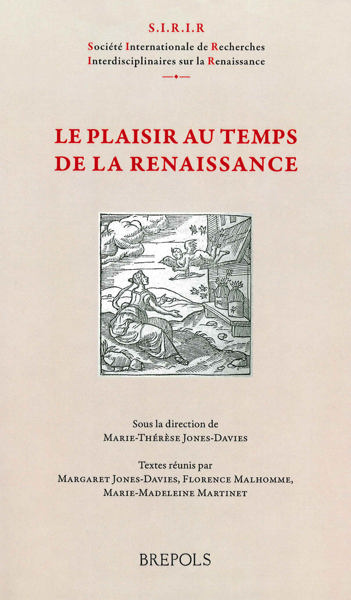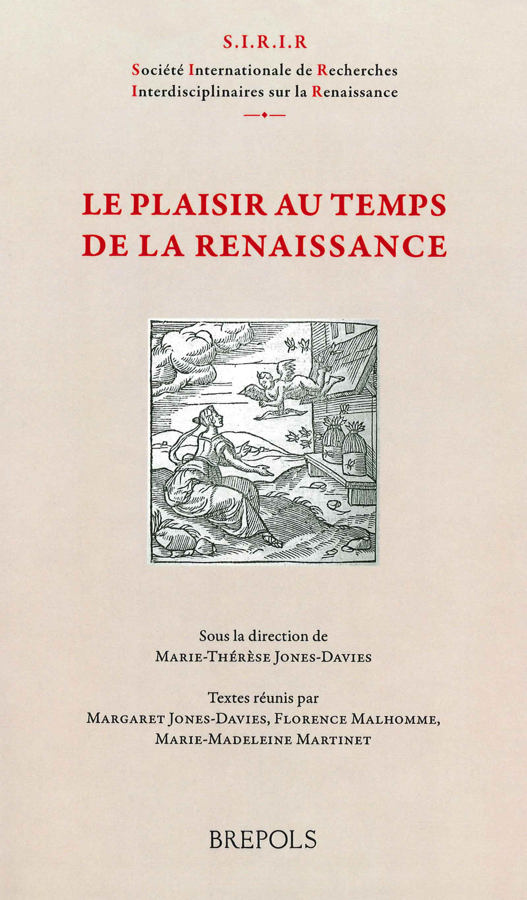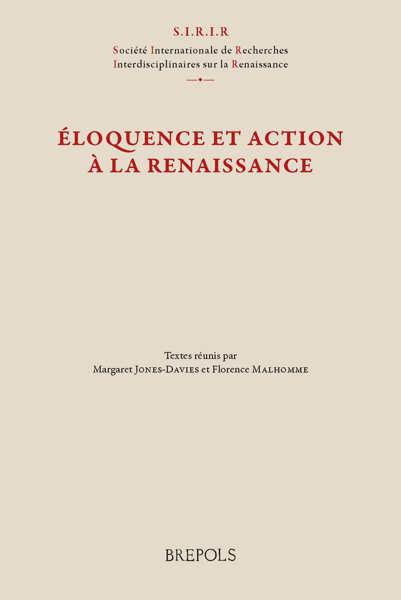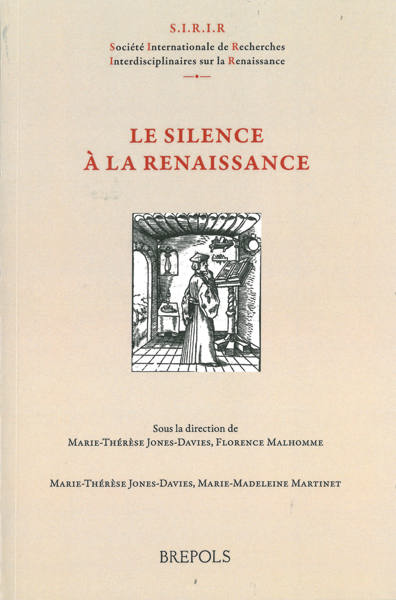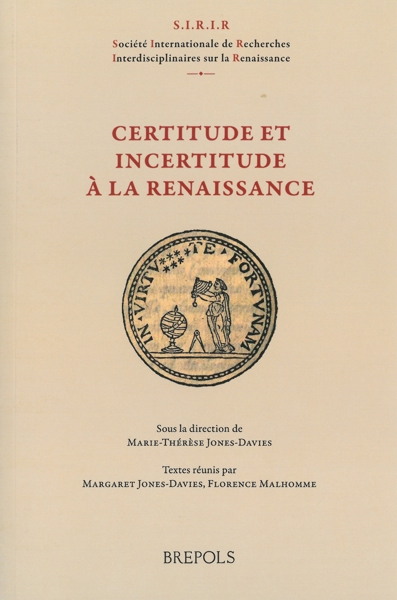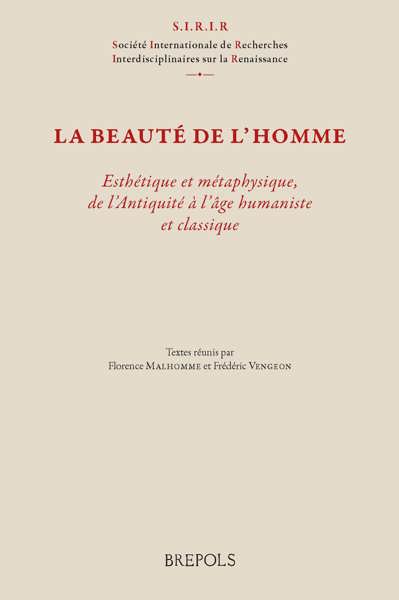
Le Plaisir au temps de la Renaissance
M. Jones-Davies, F. Malhomme, M. Martinet (eds)
- Pages: 192 p.
- Size:156 x 234 mm
- Illustrations:5 b/w
- Language(s):French, English
- Publication Year:2011
- € 60,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-53247-9
- Paperback
- Out of Print
- € 60,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-56345-9
- E-book
- Available
"Insgesamt ein lesenswerter und anregender Einblick in die gegenwärtige Werkstatt der Renaissance-Forschung." (Anne Begenat-Neuschäfer, in: Francia-Recensio, 2013/2)
Le Plaisir est-il le Bien ? La Renaissance reprend à son compte cette question débattue depuis le Philèbe et le livre X de l’ Éthique à Nicomaque. Au XVe siècle, Lorenzo Valla, dans son dialogue Sur le Plaisir (1430), tranche dans le sens d’une identification entre le plaisir et le Bien. Il est suivi un siècle plus tard par Érasme qui n’hésite pas dans l’Épicurien (1533), à assimiler le Christ à Épicure. Et Montaigne, dans sa critique du stoïcisme, stigmatise le danger des vertus immodérées qui excluent le plaisir. Le problème que posait Platon de la possibilité d’un faux plaisir à nouveau les esprits. Et si le plaisir pensé, imaginé, rêvé, pouvait réveiller les sens, toucher le corps ? Et si les barrières s’effaçaient entre le corps et l’âme ? Réhabiliter le plaisir, c’est pouvoir assumer sa part d’ombre, le déplaisir, refuser l’abstraction de leur dissociation. Accepter le plaisir, c’est accepter la mort. C’est l’une des leçons paradoxales de Peines d’amour Perdues de Shakespeare, que la pensée baroque ne cessera d’illustrer. La Renaissance reste vigilante, comme l’avaient été les périodes précédentes, car il est un plaisir auquel il ne convient pas de laisser libre cours : le bon plaisir du absolutiste.