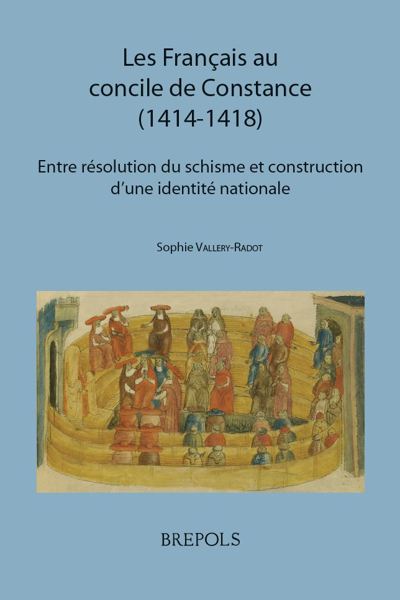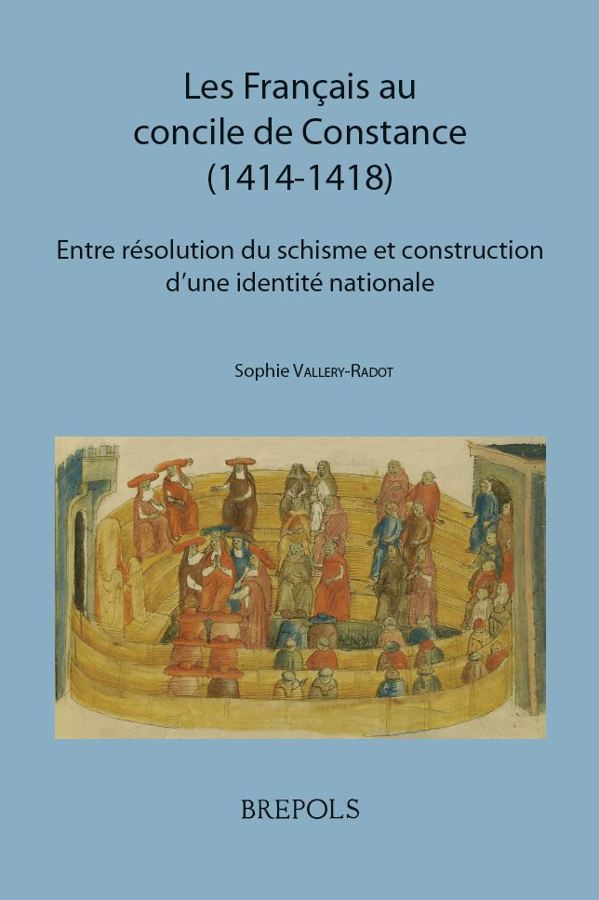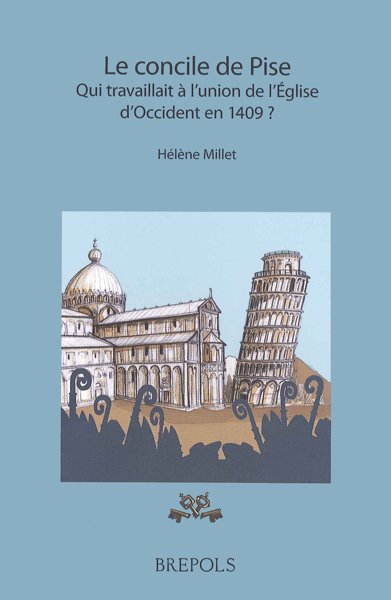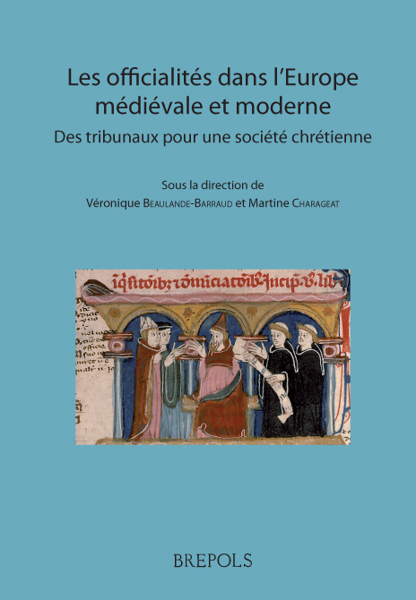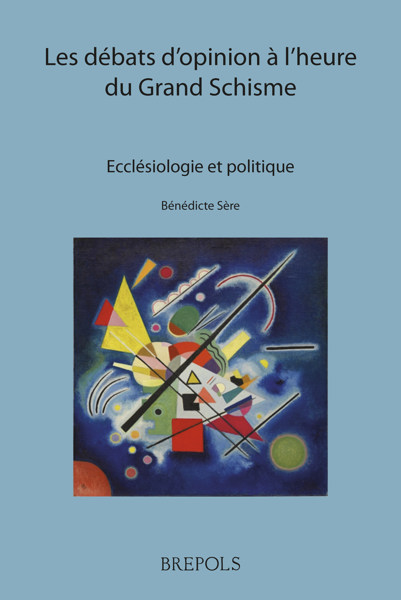
Les Français au concile de Constance (1414-1418)
Entre résolution du schisme et construction d’une identité nationale
Sophie Vallery-Radot
- Pages: 629 p.
- Size:156 x 234 mm
- Illustrations:10 b/w
- Language(s):French, Latin, German
- Publication Year:2016
- € 115,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-56464-7
- Paperback
- Available
- € 115,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-56742-6
- E-book
- Available
« Comment mieux dire que la démonstration est convaincante, les sources maîtrisées, l'analyse minutieuse et progressive, le volume d'annexes fait de notices biographiques et des matériaux scientifiques donnés en pièces justificatives d'une grande virtuosité technique ? (…) Grâce à ce livre, l'on pénètre mieux l'ambiance du concile de Constance, son quotidien, son organisation, ses jeux de pressions, ses enjeux pour la Chrétienté du temps, la caisse de résonnances qu'il représente. » (Bénédicte Sère, in Sehepunkte, 17.09.2017)
Sophie Vallery-Radot, agrégée et docteur en histoire.
Le concile de Constance est ouvert par le pape Jean XXIII en novembre 1414 afin de résoudre le schisme qui divise l’Église d’Occident depuis 1378. Les Pères conciliaires sont regroupés en quatre puis cinq nations conciliaires dont la nation française. Qui est-elle ?
Cet ouvrage se propose d’abord de répondre à cette question par le biais d’une étude prosopographique. Il s’agit d’identifier les membres de la nation française, de déterminer leur appartenance à des réseaux, qu’ils soient curiaux, familiaux, religieux, universitaires ou politiques. Ce travail s’attarde aussi sur les conflits entre les nations conciliaires et sur la construction de l’identité nationale française dans le cadre conciliaire.
À l’occasion du sixième centenaire de la réunion de ce concile, cet ouvrage apporte un regard renouvelé sur le rôle qu’y jouent les membres de la nation française.
On trouvera également dans cet ouvrage les notices biographiques des Pères conciliaires membres de la nation française.
Avis au lecteur Introduction
Première partie. Au début du concile : l’ébauche de construction d’une identité nationale
La nation française au concile de Constance
I- La formation de la nation françaiseLes réseaux au début de 1415II- Qui sont les membres de la nation française ?
I- Les réseaux curiaux, familiaux et religieuxLes premières revendications « nationales » françaises au concile (novembre 1414 à fin mars 1415)II- Les réseaux universitaires
III- Les réseaux politiques
I- Un contexte politique et religieux favorable à l’unité des FrançaisConclusion de la première partieII- L’arrivée de l’ambassade du roi de France et ses prétentions « nationalistes »
III- Le premier combat de la « nation France » au concile
Deuxième partie. La nation française dans la tourmente (21 mars 1415 – 27 janvier 1417)
La nation française désunie
I- La nation française victime de la fuite du papeSigismond, à l’origine du réveil du sentiment national françaisII- L’apparent délitement de la nation française
III- Des références persistantes à des valeurs communes
I- La réprobation de la mainmise de Sigismond sur le concile (21 mars – 18 juillet 1415)Le concile : un champ de bataille franco-anglaisII- Le revirement de Sigismond, cause d’une poussée du nationalisme français (juillet 1415-janvier 1417)
I- La dénonciation de l’existence d’une nation conciliaire anglaiseConclusion de la deuxième partieII- L’initiative française : un échec relatif
Troisième partie. Le sursaut national des Français dans un climat de crise (de janvier 1417 à la fin du concile)
La nation française en danger
I- La mise en place d’une coalition anti-française au concileLa reprise en main de la nation françaiseII- La lutte des Anglais contre les prétentions françaises
III- Les agressions ininterrompues de Sigismond à l’encontre des Français
I- Le renforcement de l’autonomie de la nation françaiseLes dérives du proto-nationalisme armagnac et l’échec relatif des « Gallicans » au concileII- La lutte contre les dissidents de la nation française
III- Le bref retour de la prédominance française dans le concert des nations
I- Les Armagnacs et l’affirmation d’un gallicanisme radicalConclusionII- La nation française au concile, victime des aléas et des troubles politiques du royaume de France
III- Le maintien d’un élan national