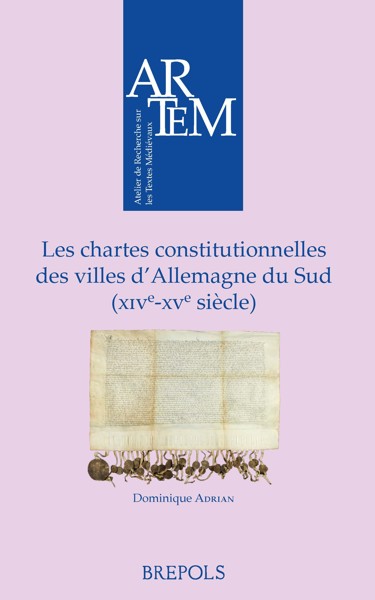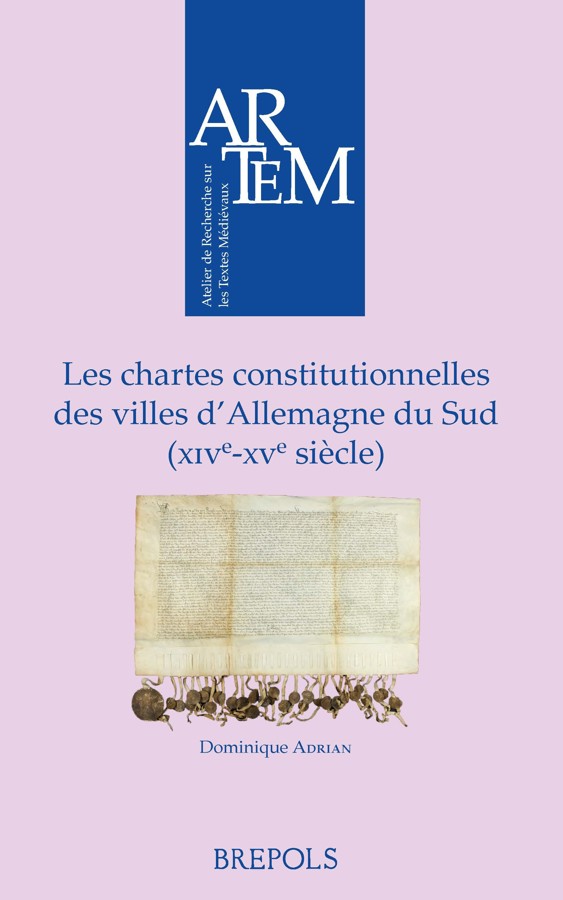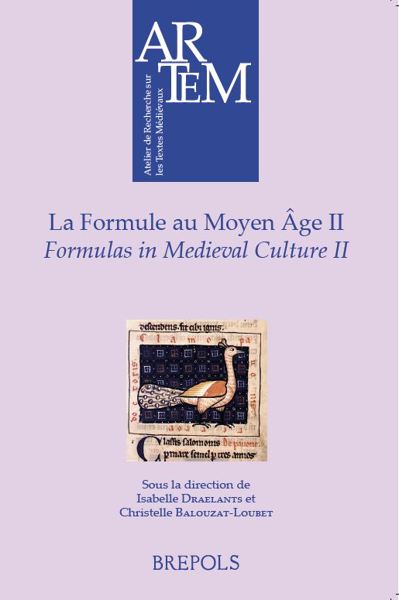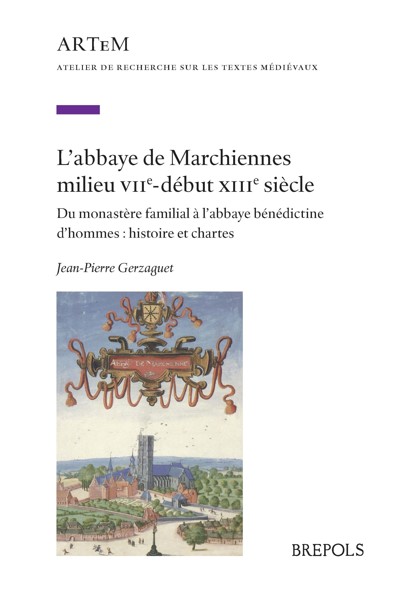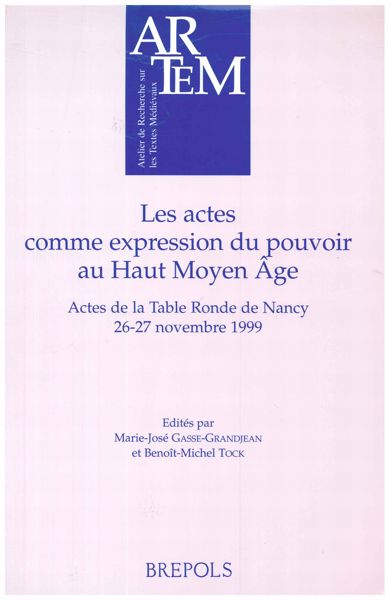
Les chartes constitutionnelles des villes d’Allemagne du Sud (XIVe-XVe siècle)
Dominique Adrian
- Pages: 206 p.
- Size:156 x 234 mm
- Illustrations:1 maps b/w
- Language(s):French
- Publication Year:2021
- € 65,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-58938-1
- Hardback
- Available
- € 65,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-58939-8
- E-book
- Available
Une pensée politique en action: les villes d’Empire à la fin du Moyen Âge et la représentation populaire
“Insgesamt gesehen ist das Buch, vor allem für französische Leser, sehr interessant, besonders für Fragestellungen aus dem Bereich der Verschriftlichung und des Umgangs mit Schriftlichkeit.” (Gisela Naegle, in Francia-Recensio, 1, 2022)
« D.A. produit ainsi un livre remarquablement dense et gourmand de détails diplomatiques, d’une grande exigence scientifique. Avec le même goût de l’explicite que les auteurs des chartes, et malgré les difficultés que constitue une histoire comparée et particulièrement une histoire comparée du Saint-Empire, D.A. fournit un grand nombre d’aides et de rappels pour que le lecteur trouve son chemin à travers la jungle des villes et des termes contemporains et historiographiques : une contribution francophone majeure à l’étude des pays allemands. » (Jean-Dominique Delle Luche, dans Le Moyen Âge, 129/2, 2023, p. 619)
Dominique Adrian, ancient élève de l’École normale supérieure, est docteur en histoire et chercheur associé au CRULH/Université de Lorraine. Ses recherches portent sur la vie politique des villes d’Allemagne du Sud, dans une perspective à la fois culturelle et institutionnelle. Il s’intéresse en particulier à la reception des phénomènes politiques par les sociétés urbaines, au-delà des élites.
Les sociétés des villes d’Allemagne du Sud n’ont pas peur de l’innovation à la fin du Moyen Âge : sur un siècle (fin xiiie-fin xive siècle), beaucoup d’entre elles créent des régimes politiques intégrant des groupes sociaux jusqu’alors exclus de toute participation, sur un principe commun décliné en fonction des situations locales : le conseil urbain est désormais constitué presque partout de délégations de corps de métier (Zünfte).
Les citadins ne se contentent pas de cette première innovation. Dans beaucoup de cas, ils procèdent avec grand soin à la mise par écrit de ces dispositions : ce sont ces chartes constitutionnelles qui sont au centre de ce livre. Le passage à l’écrit n’est jamais une évidence ; les difficultés rencontrées par leurs auteurs témoignent de l’importance de cette mise par écrit pour les sociétés qui l’ont produite. Qui sont leurs auteurs, comment ont-ils travaillé ? Eux qui n’étaient sans doute pas en contact avec la théorie savante de leur temps n’ont pas laissé de texte théorique pour éclairer leur démarche, mais ces chartes permettent de dégager les grandes lignes de leur pensée politique.
Le soin pris à décrire le nouveau dispositif institutionnel le montre : il ne s’agit pas seulement d’un acte administratif, mais d’un véritable programme politique et social. Ces chartes sont le produit de périodes de troubles, avec ou plus souvent sans violence, pour mettre fin à l’exclusivité politique des élites traditionnelles, en assurant un équilibre politique de long terme. Pour éviter à la fois le retour à un pouvoir oligarchique et la déstabilisation par les masses populaires, leurs concepteurs ont une série de choix à effectuer. Qui désigne les représentants des métiers ? Quel poids ont les différents métiers ? Quel poids politique les élites traditionnelles conservent-elles ?
Les promesses démocratiques annoncées ont-elles été tenues ? Il y a bien des manières pour les élites de contourner les garanties d’ouverture offertes par les chartes, mais les métiers, fortunés ou non, se montrent attachés au système et au texte des chartes qui leur donnaient une dignité nouvelle. Cet apprentissage de la démocratie, pour imparfait qu’il soit, témoigne de la créativité intellectuelle des bourgeois de ces villes.
Préface
Introduction
I. Des textes
Une charte ?II. Circonstances
Le seuil de l’écritBourgeois, Souverains, arbitresPlusieurs chartes
Chartes, codes, coutume
Désignations
Nature juridique de ces chartes
Le momentIII. Des systèmesProcédures et influences
Écrire les institutions municipales
Expédition, promulgation, serments
Principes constitutionnelsConclusion : circulations interurbaines
Esquisse de vocabulaire du politiqueLes groupes sociaux à l’œuvreLes métiers au pouvoir
Les ZünfteLe système des ConseilsLes patriciens
Le Petit conseilLes magistraturesLe Grand conseil
La commune
Les élections
Les représentants seigneuriauxAutres dispositionsLes maires
Contrôles et contre-pouvoirsLa politique et au-delà
Annexes
Les chartes constitutionnelles et leurs éditionsBibliographieCharte de Wangen, 11 novembre 1381
AbréviationsIndex géographiqueSources manuscrites
Sources imprimées
Études