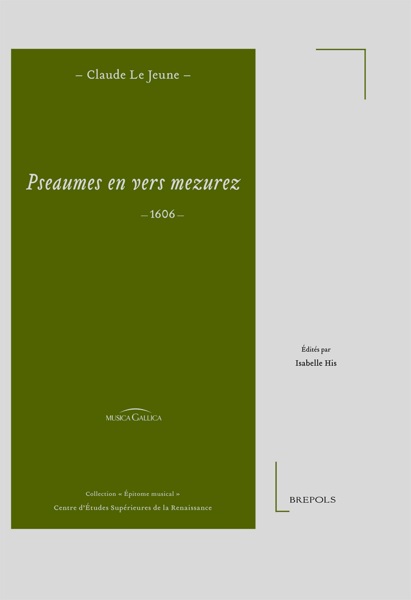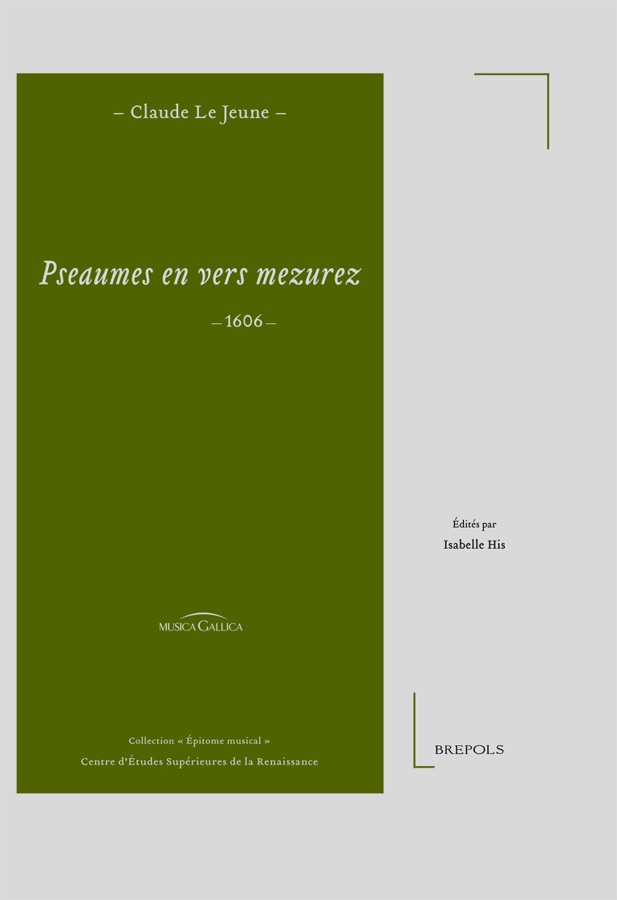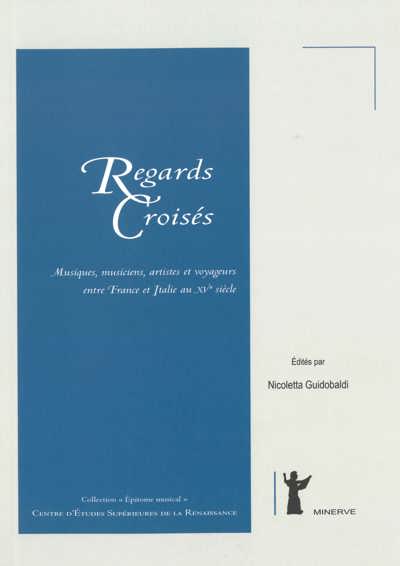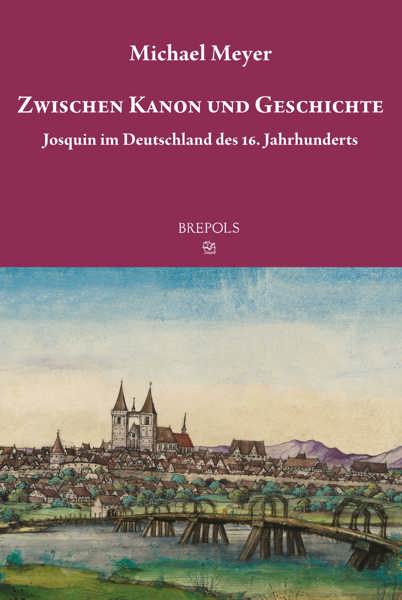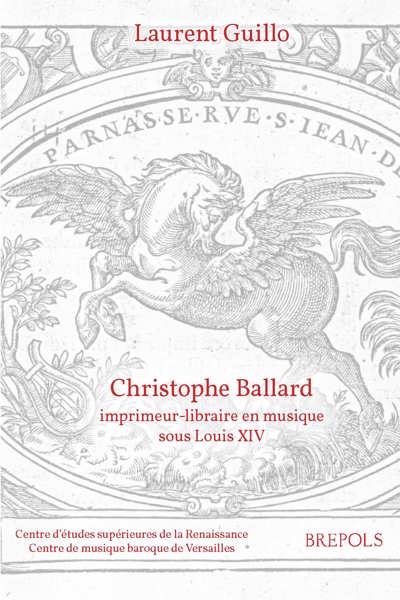
Claude Le Jeune, Pseaumes en vers mezurez - 1606
Isabelle His (ed)
- Pages: 230 p.
- Size:185 x 270 mm
- Language(s):French
- Publication Year:2007
- € 40,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-52563-1
- Paperback
- Available
De récentes découvertes (travaux de D. Lamothe) semblent confirmer le contexte très particulier de ce corpus : 4 des psaumes mesurés sont en effet bâtis sur des cantus firmus (tonus peregrinus, sixième ton « royal ») qui viennent cristalliser une évidente volonté oecuménique : des psaumes écrits pour un roi catholique, par un poète catholique (Jean Antoine de Baïf) et un poète protestant (Agrippa d’Aubigné), mis en musique par un huguenot déclaré (Claude Le Jeune).
Parmi les 27 pièces françaises et latines d’effectifs variés se trouve une exception notable : un Te Deum en français à 6 voix. Si les textes d’Agrippa d’Aubigné sont probablement d’origine, ceux de Jean Antoine de Baïf forment sans doute une série remaniée (rimée) sur le tard par Odet de La Noue pour cette publication ; avec la précieuse collaboration du professeur Jean Vignes, spécialiste de ce poète, cette édition propose donc pour la première fois, lorsque l’alternative est possible, sa poésie originale tirée du fameux Manuscrit BNF Ms. Fr. 19140. Cette double présentation fera toute la différence avec l’ancienne édition (1905-1906, épuisée) d’Henry Expert.