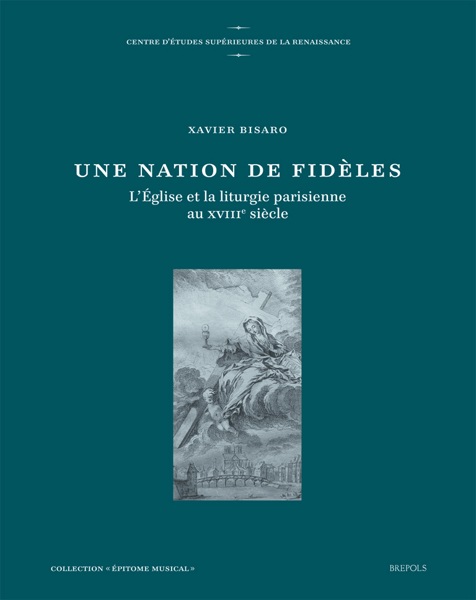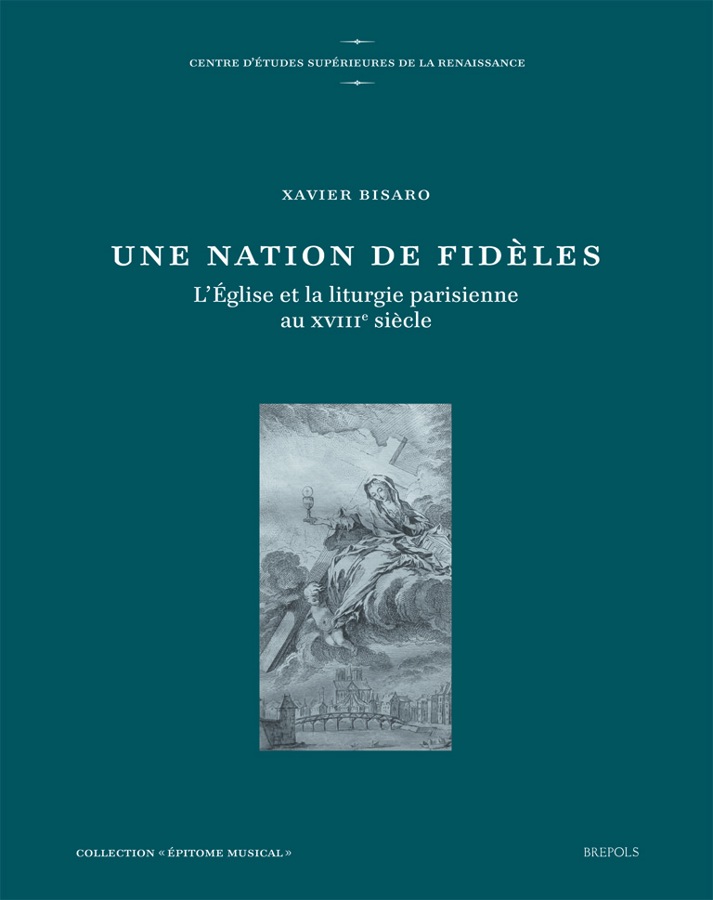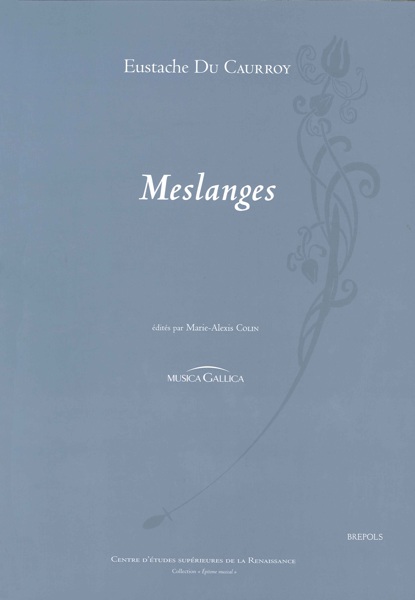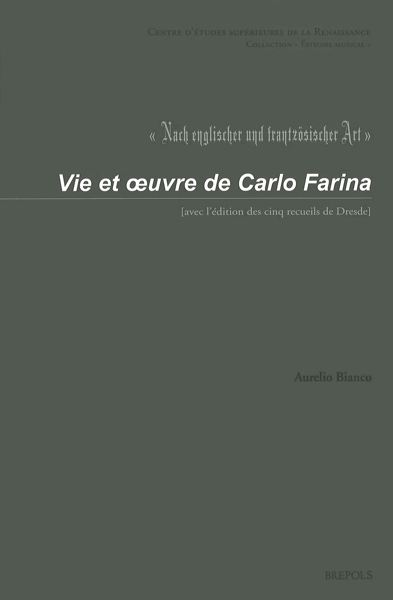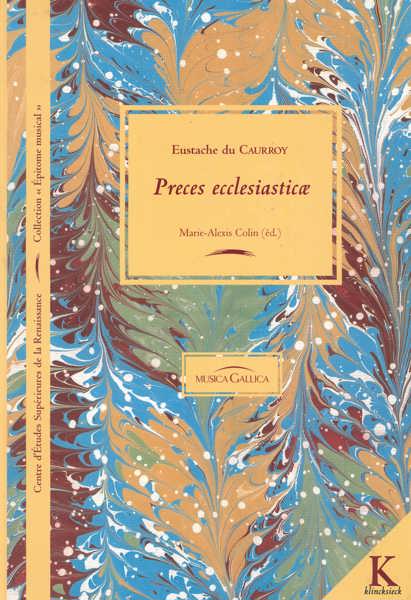
Une nation de fidèles: l'Église et la liturgie parisienne au XVIIIe siècle
Xavier Bisaro
- Pages: 480 p.
- Size:190 x 240 mm
- Language(s):French
- Publication Year:2006
- € 90,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-52343-9
- Paperback
- Available
Mais ce qui n’aurait dû être qu’une contribution de plus aux liturgies néogallicanes témoigna aussitôt d’une nouvelle phase de l’histoire religieuse de l’ensemble du royaume. Projets d’adoption des livres parisiens par d’autres diocèses avant même la fin de leur impression, dynamisme commercial des libraires en charge de leur diffusion, embrasement des milieux ecclésiastiques à leur sujet : la vocation diocésaine de cette réforme liturgique dépasse aussitôt ses limites officielles. Le seconde partie de l’ouvrage est ainsi consacrée au devenir des textes et du chant de la liturgie parisienne, bientôt appelés à fournir le quotidien liturgique d’une large partie des paroisses et des cathédrales du royaume. Néanmoins, bien loin d’un simple tropisme favorable aux productions émanant de la capitale, cet engouement pour la liturgie parisienne participe d’un effort mené à large échelle pour préparer l’église gallicane à un temps qu’elle s’efforce de comprendre pour mieux le maîtriser. Les perspectives offertes par une liturgie unifiée autour du modèle parisien sont en effet multiples, depuis la construction d’une image homogénéisée jusqu’à la renégociation du rapport aux communautés de laïcs, en passant également par l’encadrement du clergé et la pacification des querelles ecclésiastiques. Repris durant la Révolution, réactivés après le Concordat de 1802, ces objectifs s’articulent immanquablement avec le recours à la liturgie parisienne, liturgie dont cet ouvrage souligne finalement le rôle primordial dans le projet rassemblant les forces antagonistes de l’église gallicane du XVIIIe siècle, celui de l’émergence d’une Nation de fidèles.