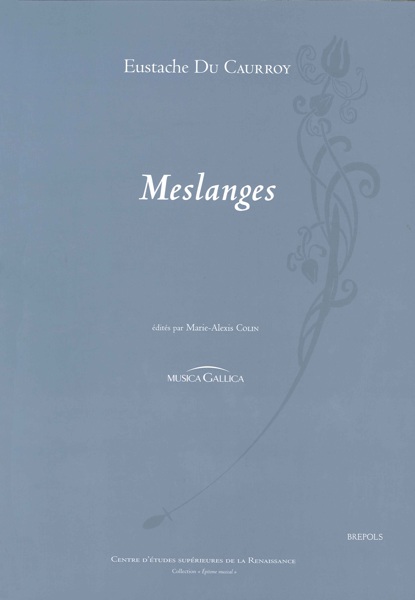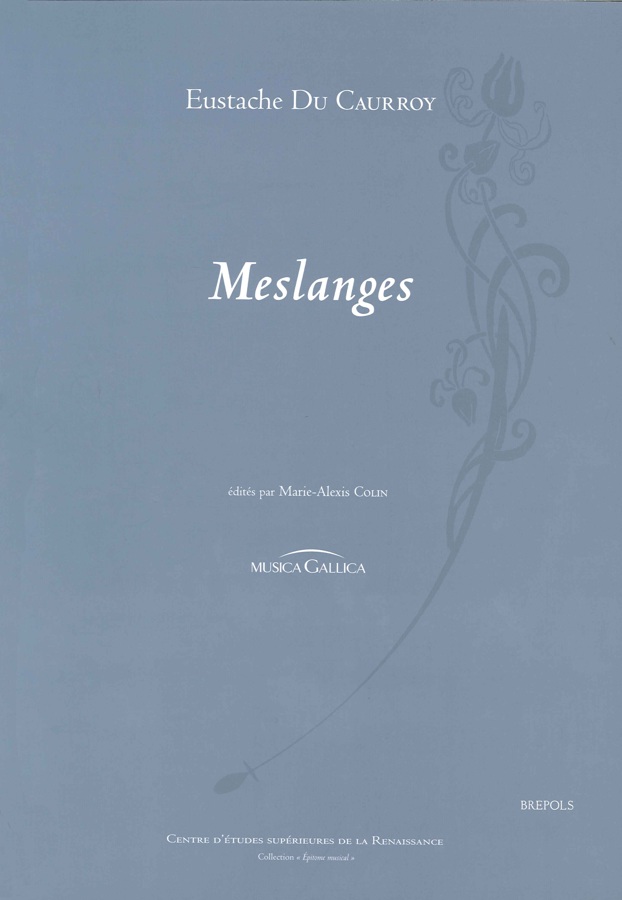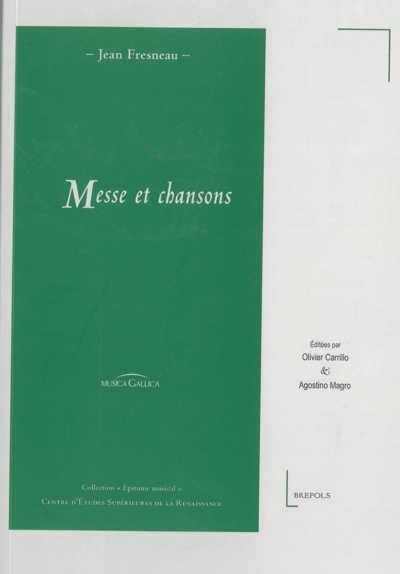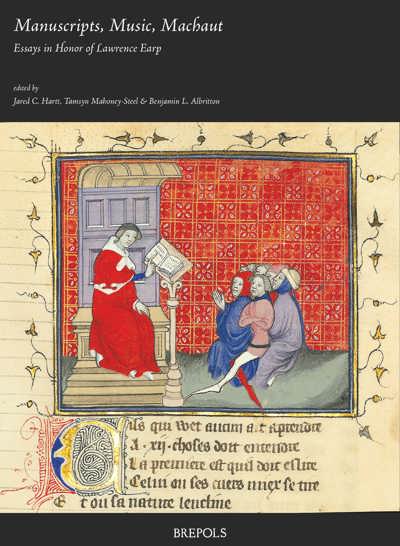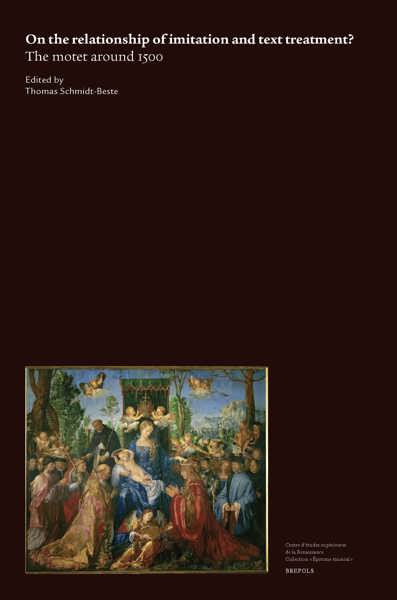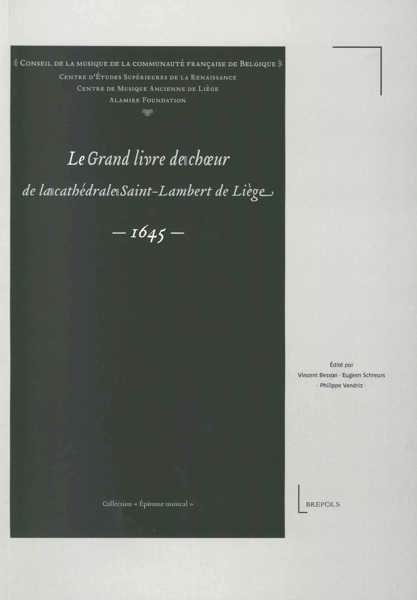
Eustache du Caurroy, Meslanges
Marie-Alexis Colin (ed)
- Pages: 420 p.
- Size:235 x 335 mm
- Illustrations:16 b/w
- Language(s):French
- Publication Year:2011
- € 40,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-51592-2
- Paperback
- Available
"This is a massive and most welcome publication." (Clifford Bartlett, in Early Music Review 144, October 2011, p. 5)
« Ce qui peut vous tromper, c'est que de nouveau tout est beau, mais n'est pas pour cela meilleur. […] La nouveauté est le guide des curieux qui leur fait mespriser leur propre Ciel et terre […]. De quoy est venu ce Proverbe: De trois Phisiciens un Atheiste, et de cinq Musiciens quatre fous, pour rechercher de nouvelles inventions et des mouvements à la mode au lieu de nous tenir dans les bons et proffonds preceptes de nos Anciens, comme Du Caurroy, Intermet et Claudin, et parmy ceux de nostre tems, Fremat, Hauxcousteaux et Cosset. »
Annibal Gantez, L'entretien des musiciens (Auxerre, Jacques Bouquet, 1643), lettre XXIX
A. Gantez (c. 1600-1668) n’est pas le seul à voir en Du Caurroy l’un des chefs de file des compositeurs académiques, apôtres (au moins en partie) d’un contrepoint savant. Dans son traité publié en 1639, Antoine Parran (1587-1650) ayant, d’après sa propre expérience, classé la musique en quatre catégories, ne décrit-il pas « la quatriesme sorte […] une Musique grandement observée, toute pleine d’industrie et de doctrine […] comme pourroit estre celle de Claudin, du Caurroy, et plusieurs autres Maistres de ce temps comme l’on peut voir au Puy de Saincte Cecile. » ? Occupés à servir les chapelles privées ou les institutions ecclésiastiques, ces compositeurs, parfois récompensés lors de joutes musicales, ne pratiquent guère l’air de cour, genre en plein épanouissement qui ravit les salons de Louis XIII comme les demeures plus modestes, pour le plus grand bénéfice de l'imprimeur parisien Pierre Ballard – celui-là même qui imprime l’essentiel de la musique que nous connaissons de Du Caurroy. Ces musiciens – au nombre desquels figurent Nicolas Formé (1567-1638), qui succède à Du Caurroy comme responsable de la musique de la chapelle royale, Jean de Bournonville (c. 1585-1632), Artus Aux-Cousteaux (c. 1590- c.1656) pratiquent une musique dont le style s’apparente à celui que Du Caurroy a indirectement hérité de Josquin des Prez (c. 1450-1521) et d’Adrian Willaert (c. 1490-1562), entre autres ; cette manière, apparue comme désuète dès le dernier quart du 16e siècle, s’accorde difficilement avec la simplicité de l’air de cour (simplicité exprimée tant dans le sujet et la forme littéraires, que dans le profil mélodique, les procédés de composition et la forme strophique). Ainsi, en marge de certains écrits de théoriciens contemporains - par Salomon de Caus (c.1576-1626), Antoine Du Cousu (c.1600-1658), Marin Mersenne (1588-1648), Antoine Parran (1587-1650) - qui louent en Du Caurroy l’héritier français de Gioseffo Zarlino, les adeptes du stile antico pratiqué en France durant la première moitié du 17e siècle rendent à leur manière hommage au compositeur.