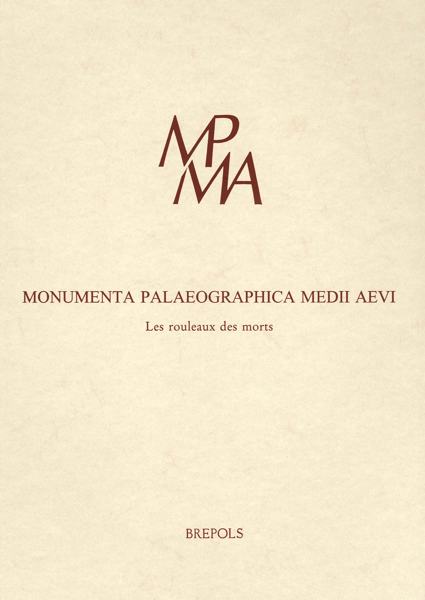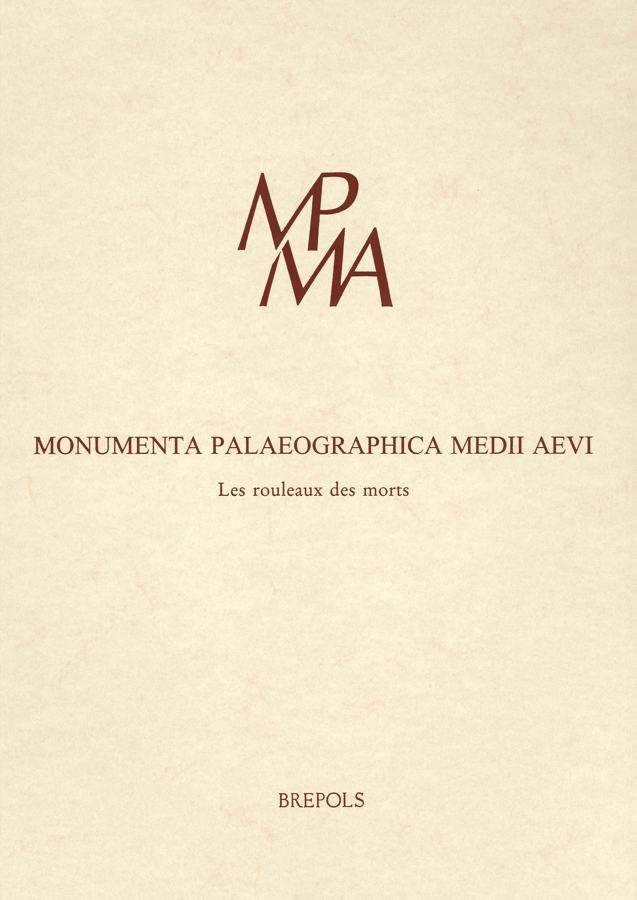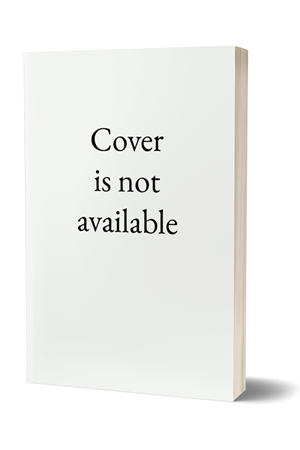
Les rouleaux des morts
J. Dufour
- Pages: 296 p.
- Size:305 x 440 mm
- Illustrations:103 b/w, 6 col.
- Language(s):French, Latin
- Publication Year:2010
- € 125,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-51364-5
- Hardback
- Available
"L'intérêt des rouleaux des morts est tout à la fois culturel, paléographique, "codicologique" et prosopographique; ils éclairent l'histoire de la peinture médiévale, celle des mentalités et la connaissance des routes et des itinéraires. ... Ce volume de planches est une superbe outil pour les exercices de paléographie et un précieux matériau de comparaison pour les écritures datées." (J. Pycke, dans Revue d'histoire de l'Église de France)
"On ne peut que féliciter l'auteur (et l'éditeur) d'avoir pris cette belle initiative et de mettre ainsi à la disposition du public la reproduction de documents aussi passionnants qu'intéressants pour la paléographie." (B.-M. Tock, dans Scriptorium. Bulletin Codicologique, 2010, 2, p. 257)
"Ce volume de planches est en outre un superbe outil pour les exercices de paléographie et un précieux matériau de comparaison pour les écritures datées." (Jacques Pycke, dans: Revue d'Histoire Ecclésiastique, 2014, 109/3-4, p. 983-986)
Si la plupart des brefs mortuaires ont disparu en raison de leur petite taille, les rouleaux des morts ont eux-mêmes beaucoup souffert au cours des âges, nombre d’entre eux ayant même été dépecés pour servir de feuilles de garde à des mss. Au total, on ne conserve (en original, par des copies ou des éditions anciennes) qu’environ 450 pièces, alors que certainement des milliers ont circulé. Les plus anciens originaux connus sont des fragments de la seconde moitié du Xe s.
Plusieurs critères ont prévalu pour le choix des quelque 110 planches présentées. Tout d’abord, bien sûr, un critère paléographique, car l’ensemble des écritures est daté et localisé avec précision, ou du moins datable avec une fourchette chronologique étroite. On trouvera dans ce volume des écritures livresques, des mentions avec lettres enclavées (à rapprocher de celles des pages-titres des mss. ou des inscriptions lapidaires) comme des écritures cursives ou personnelles ; les pièces retenues ont les origines les plus diverses, françaises, anglaises, belges, hollandaises, allemandes, etc. Ensuite, un critère historique : une copie du début du XIXe s. témoigne de la mise en circulation de rouleaux mortuaires par l’abbaye de Ripoll, malheureusement incendiée peu après ; ou encore un titre de Noyon montre l’âpreté des luttes intercommunautaires à propos des reliques. Également, un intérêt documentaire, comme la charte scellée, tenant lieu de « rotulus », de l’abbesse de Pielenhofen (Bavière ; 1435). Ou encore, un intérêt artistique avec la reproduction des magnifiques dessins ornant le début du rouleau de Lucy de Vere, prieure de Castle Hedingham (Essex ; vers 1230) ou préparés pour le rouleau de John Islip, abbé de Westminster (vers 1532). Dans bien des cas, les itinéraires peuvent être établis avec une grande précision : une carte retrace celui d’un rouleau mortuaire expédié en 1406 par Saint-Bavon de Gand qui, en 20 mois, recueillit plus de 800 titres d’Amsterdam au nord à Barcelone au sud. Enfin, sont reproduits divers brefs mortuaires, documents à peu près ignorés jusqu’alors.
A noter que le présent ouvrage illustre parfaitement le Recueil des rouleaux des morts, publié sous la direction de J. Favier par J. Dufour dans la série in-4° des Obituaires du Recueil des historiens de la France de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres (déjà 4 vol. depuis 2005).