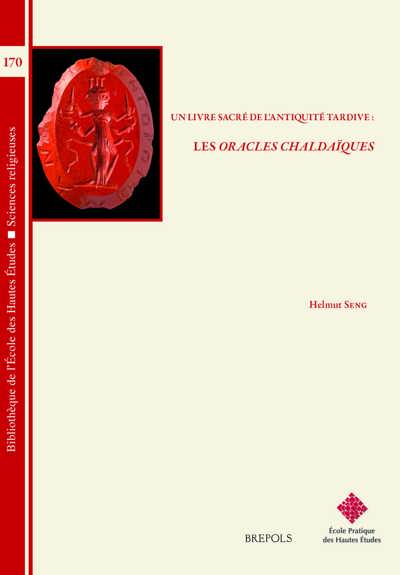
Un livre sacré de l'Antiquité tardive : les Oracles Chaldaïques
View publication
«L'impressionant volume qui en résulte tire son unité non seulement d'une somptueuse bibliographie finale mais surtout d'une introduction qui survole les différentes données des problèmes soulevés. ... On peut mesurer, par ce bref survol des thèmes traités, la richesse et la nouveauté qu'apporte ce volume dans sa dimension comparative.» (F. Aubin dans Archives de Sciences sociales des Religions, 2001, n° 116)
"Une contribution importante à l'histoire des mentalités et à l'étude comparée des religions." (Ève Feuillebois-Piérunek, dans Abstracta Iranica 23, février 2010, URL http://abstractairanica.revues.org/document35113.html)